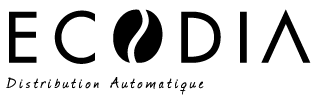À mesure que les distributeurs deviennent plus intelligents, connectés et autonomes, une question se pose rarement mais mérite toute notre attention :
qui pilote réellement l’expérience boisson dans une entreprise aujourd’hui ?
Avant, tout était clair. Un service générait une demande. Une personne commandait, vérifiait, réapprovisionnait.
Aujourd’hui, une machine signale son propre niveau de stock, déclenche une alerte de maintenance, adapte l’offre selon l’horaire, et parfois… anticipe même les besoins.
Sur le papier, tout cela semble fluide. Dans la réalité, cette transformation brouille subtilement les lignes de responsabilité.
L’automatisation a effacé l’opérateur — mais pas les attentes
Les distributeurs nouvelle génération s’auto-surveillent, s’auto-nettoient, s’auto-réglent.
Mais en parallèle, les collaborateurs ont toujours des attentes précises :
- Pourquoi ma boisson préférée a-t-elle disparu ?
- Qui décide du changement de marque ?
- À qui signaler un dysfonctionnement discret ?
- Pourquoi l’eau est plus chaude que d’habitude ?
Or, dans un modèle automatisé, il n’y a souvent plus d’interlocuteur clair.
Et cette absence de repère peut entraîner des frustrations silencieuses, difficilement traçables.
De l’intendance à l’intelligence : une redistribution floue des rôles
Avec l’automatisation, les rôles se déplacent. Mais souvent, ils le font sans être redéfinis.
| Avant | Maintenant |
| Un office manager gérait la commande | La machine notifie directement le fournisseur |
| Un technicien passait en routine | L’intervention est déclenchée automatiquement |
| Un collaborateur faisait remonter un problème | L’IA surveille en temps réel (mais pas tout) |
Mais qui coordonne tout cela ?
Dans de nombreuses entreprises, la chaîne est partiellement “déshumanisée”, sans qu’un nouveau cadre de gouvernance n’ait été mis en place.
Ce qu’on ne pilote plus (mais qu’on devrait)
Voici des aspects de l’expérience boisson que l’automatisation ne couvre pas toujours — et qui nécessitent un pilotage humain, souvent oublié :
- La cohérence de l’offre produit : alignement avec les préférences réelles des collaborateurs
- La qualité perçue de la pause : bruit, attente, lisibilité de l’interface
- Les retours utilisateurs non techniques : goût, température, ressenti
- La communication autour des changements : pourquoi tel produit n’est plus là ?
Sans interlocuteur dédié, ces éléments s’érodent doucement… jusqu’à ce que la pause ne devienne plus un plaisir, mais une habitude fonctionnelle.
Faut-il désigner un “référent expérience café” ?
Cela peut sembler exagéré. Pourtant, certaines entreprises pionnières dans la qualité de vie au travail l’ont bien compris :
même automatisée, une prestation demande un pilotage.
Pas forcément technique, mais expérientiel.
Un rôle intermédiaire qui :
- Écoute les feedbacks terrain
- Coordonne avec le fournisseur ou le prestataire
- Vérifie la cohérence entre technologie et usage réel
- Anticipe les ajustements selon les cycles de vie interne (séminaires, pics de présence, équipes hybrides)
C’est une logique d’orchestration légère, qui redonne de la cohérence à un système devenu très fragmenté.
L’automatisation n’est pas une délégation totale
Automatiser, ce n’est pas abandonner.
C’est déplacer la responsabilité de l’opérationnel vers la supervision stratégique.
Et si l’on veut que le service boisson reste un vecteur de bien-être, de confort et de fluidité, il faut poser la question essentielle :
à qui revient aujourd’hui le rôle d’en assurer la qualité vécue ?
Sans réponse claire, même la machine la plus intelligente ne pourra pas combler le vide.